Risque bioterroriste et
médecine générale
Risque bioterroriste et
médecine générale
Si, en raison du caractère universellement rejeté (honteux) des agents biologiques militaires, ceux-ci ne risquent pas d’êtres utilisés sur les champs de bataille à venir, il n’est pas exclu que des groupes terroristes les emploient comme armes de destruction massive, ou dans le but, plus facile à atteindre, d’effrayer les populations. Il n’est en effet pas nécessaire de tuer des dizaines de milliers de personnes pour provoquer un mouvement de panique : l’annonce de quelques cas de charbon, la menace d’une attaque faisant usage du bacille de la peste ou du virus Ébola, suffiraient à déstructurer efficacement les sociétés cibles, et à déstabiliser l’économie.
Au contraire d’une explosion, ou de la libération d’un gaz de combat (comme par exemple le sarin dans le métro de Tokyo), qui sollicitent immédiatement les équipes d’urgentistes, l’utilisation discrète d’un agent biologique entrainerait un délai avant que les victimes ne consultent un médecin. Il s’agit de la période d’incubation : les individus poursuivront sans heurts ou presque leurs activités quotidiennes jusqu’à l’apparition d’un trouble plus ou moins intense justifiant un recours à un professionnel de la santé. Selon les caractéristiques socio-économiques, démographiques de la population atteinte, les victimes consulteront les services d’urgence des hôpitaux généraux, ou, plus souvent, leur médecin généraliste.
Or, ces intervenants de première ligne ne sont pas formés au diagnostic de pathologies telles que le charbon, la variole, ni même la peste. Certains agents biologiques causent des maladies éradiquées, qu’il est donc en principe impossible de rencontrer dans la pratique clinique, comme la variole ; d’autres sont à l’origine d’affections rares dans nos contrées : charbon, peste…
Dans les facultés de médecine, on apprend à diagnostiquer le diabète, l’hypertension, une ischémie cardiaque, un accident vasculaire cérébral, une crise de goutte… mais on n’enseigne pas les critères diagnostiques de la variole ou de la peste pulmonaire. Il est certes indéniable que « les maladies rares sont rares », et qu’une éruption vésiculaire a infiniment plus de chance d’être une bonne vieille varicelle qu’une variole, mais négliger un diagnostic différentiel aussi grave sous prétexte que sa probabilité semble infinitésimale pourrait conduire à une catastrophe en termes de santé publique mondiale. Les bacilles de Yersin, celui du charbon, le virus varioleux, ne sont mentionnés que de façon anecdotiques dans les cours destinés aux futurs praticiens de l’art de guérir. Il faut également noter, dans la formation de base, l’absence de préparation aux situations de catastrophe. L’on n’envisage que la maladie survenant naturellement, conséquence de la rencontre accidentelle d’un hôte, d’un agent pathogène, dans un environnement favorable. La possibilité d’une utilisation malveillante, intentionnelle, de microorganismes n’est pas évoquée.
En infectiologie, chaque heure compte. Plus longtemps un sujet demeure dans la nature, sans diagnostic, sans mesures d’isolement, plus il est susceptible de contaminer une autre personne, d’amplifier l’épidémie naissante ; en outre, un délai excessif entre les premiers symptômes et l’instauration d’un traitement peut avoir, selon la maladie, des conséquences funestes.
En conséquence, le généraliste, qu’il soit jeune ou plus âgé, se trouvera bien démuni face à une situation pour laquelle il n’a pas été formé. D’abord, il est très improbable qu’il suspecte, puis diagnostique une attaque bioterroriste, mais ensuite, que ferait-il ? Sait-il qui contacter ? Connaît-il les moyens dont dispose le gouvernement, les régions, les villes pour faire face à pareil incident ?
S’il semble judicieux, voire indispensable d’un point de vue pédagogique de négliger les affections rarissimes non transmissibles, qui peuvent être réservées à l’expertise des seuls spécialistes, le cursus médical devrait comprendre les bases de la médecine de catastrophe et de la réaction à une attaque terroriste, qu’elle soit biologique ou chimique.
L’on poursuit parfois devant les tribunaux le médecin qui manque un diagnostic, ou qui commet une erreur en instaurant un traitement, mais que penser du docteur qui renvoie chez lui un individu atteint de petite vérole ?
Si les médecins belges ne se préoccupent guère de ces maladies exotiques, propres aux contrées en voie de développement pour certaines, cela n’est point surprenant. La Belgique, en effet, ne possède pas un niveau de « preparedness » comparable à celui de ses alliés militaires ou de ses voisins immédiats.
Il semble aller de soi que les États-Unis, nettement plus dominants dans les domaines de la politique internationale et de l’engagement militaire, aient dû se protéger du terrorisme en général, et du bioterrorisme en particulier. Les faits ont démontré d’ailleurs que cela s’avérait bien nécessaire. La France, elle aussi, influente sur le plan international, bien davantage que notre plat pays, doit également ressentir ce besoin. Mais nous ? Nous ne faisons de mal à personne ? Qui donc voudrait souhaiter nous attaquer ?
Il importe de garder à l’esprit que la Belgique fait partie de l’OTAN, dont elle abrite le SHAPE, que Bruxelles est la capitale de l’Union Européenne, que la globalisation de l’économie implique aussi celle de la pauvreté, de la contestation, des extrémismes. Il a existé, il y aura encore, des terroristes nés sur le territoire national, ou de passage sur celui-ci, prêts à user de toute arme pour supporter leur cause.





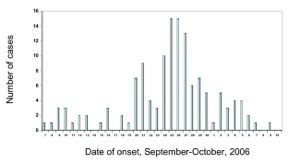


A gauche : SHAPE ; à droite : Berlaymont